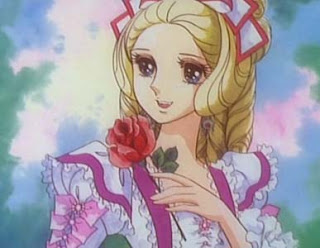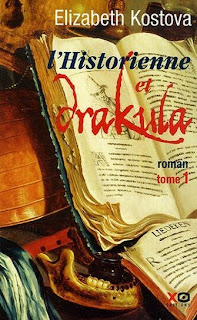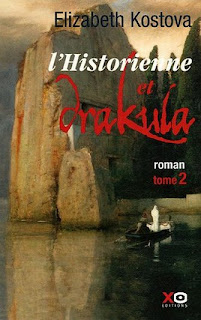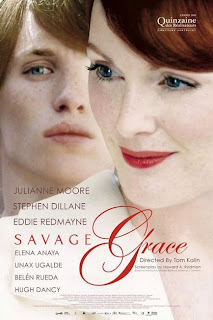Réalisé par Jess Franco en 1976.
Avec Klaus Kinski, Josephine Chaplin, Lina Romay...
*
***
*
1888, dans le quartier de Whitechapel rôde l'inquiétante silhouette de celui que tout le monde appelle Jack The Ripper. Les meurtres de prostituées se multiplient et la police patauge littéralement dans la semoule. Le Dr Dennis Orloff, qui tiens un cabinet au rez de chaussé d'une jolie pension de famille et qui sort chaque nuit pour ne rentrer qu'au petit matin semble se dérober chaque fois qu'on aborde le sujet des meurtres ou qu'on lui parmle de sa mère...cet homme si sympathique en apparence, si aimable et si bon, qui se ballade dans les ruelles sombres avec une cape, des gants noirs et un scalpel ne serait-il pas en réalité Jack l'éventreur lui-même ?
***
Comme je l'ai dit dans l'article sur le film de 1953 avec Jack Palance, les films mettant en scène le célèbre tueur en série sont nombreux, et les adaptations les moins connues ne sont pas forcément les moins intéressantes. C'est le cas de ce Jess Franco's Jack the Ripper mettant en scène deux têtes d'affiches plus qu'attrayantes : Klaus Kinski et Joséphine Chaplin.
Franco est loin d'être un novice dans le genre et cette nouvelle et très libre version de la funeste histoire de jack l'éventreur et par bien des aspect semblable à un précédent Thriller de Franco : L'Horrible Dr Orloff (1962) avec Howard Vernon (remake officieux du superbe Les yeux sans visage de Franju qui connaitra une version modernisée en 1988, par Franco lui-même avec Helmut Berger ; Les prédateurs de la nuit). Mais plutôt que d'entrer dans les comparaisons que seul pourront saisir les connaisseurs, Let's talk about the movie !
L'entrée en matière de ce Jack The Ripper est des plus classique, le générique en lettre rouge suit une jeune prostituée dans les rues de Whitechapel et on ne doute pas un seul instant du sort qui l'attend. Il en va de même pour le reste du film, aucun rebondissement n'est une surprise, Franco n'est pas (plus) habitué à faire dans la subtilité.
Hey non ! N'éteignez pas votre téléviseur !!! N'oubliez pas que cette version est loin d'être la moins intéressante, c'est ce que j'ai dit du moins alors à ce stade de la critique croyez-moi et croyez en Jess !
Message à l'attention des non-initiés :
Il est facil de manger du jack l'éventreur à toutes les sauces, et beaucoup on choisit le ketchup, qu'à celà ne tienne, Jess y met la double dose !
Facil aussi de matiner la recette d'un soupçon d'érotisme : Pour Jess ça sera quelques louches.
Facil enfin de faire passer un paisible quartier suisse pour le glauque quartier de Whitechapel, Jess en use et en abuse et on y voit que du bleu...

Maintenant passons aux choses sérieuse si tant est qu'on puisse être sérieux lorsqu'on parle de ce cher Jess Franco.
Entouré comme de coutume d'un casting de choix, Franco se lance dans l'aventure, avec en main un scénario pré-maché, en partie recyclé de L'Horrible Dr Orloff considéré encore aujourd'hui comme un véritable classique. La musique est confiée à un illustre inconnu qui compose un thème unique mais efficace pour les 92 minutes de métrage, la photographie ne s'encombre d'aucun filtre et les éclairages redoublent d'inventivité pour créer une atmosphère sombre et glauque à souhait qui n'a rien à envier aux autres productions du genre. Ces caractéristiques font déjà de jack The Ripper l'un des films les plus aboutis techniquement de Jess Franco, on se demandera alors pourquoi ce Ripper méconnu a sombré dans l'oublie alors que le très inférieur Les nuits de Dracula le totalement flou Rites of Frankenstein et l'abominable Abime des Mort-vivants restent gravés dans les mémoires. Réponse parce qu'il n'est justement pas assez nul pour être considéré comme une production Franco qui se respecte !!! Blague à part, j'en sais fichtrement rien !
Klaus Kinski livre une partition fort intéressante en Dr Orloff (tiens donc), serviable, excellent praticien le jour, serial killer torturé la nuit. Son regard inquiétant et fixe y est pour beaucoup et sa prestance naturelle fait le reste. Quant à Joséphine Chaplin, si son jeu n'est pas à se damner, elle reste correcte dans le rôle de la petite amie de l'inspecteur qui tombe bêtement dans les filets du tueur, histoire d'inquiéter tout le monde !
La théorie développée par Franco est moins fantasque que ce que l'ont pouvait imaginer, ici le Dr Orloff ne tue pas les femme pour leur prendre leur visage comme dans le film de 1962 (dans lequel il tente de greffer un nouveau visage à sa fille défigurée) mais s'attaque aux prostituées car sa propre mère en était une et qu'elle aurait apparemment abusé de lui (?!). L'intéressant postulat du Film de Hugo Fergonese avec Jack Palance prend une tournure quasi comique pour le non initié. Quant à moi je suis le film avec grand intérêt, mon affection pour Franco me ferait faire n'importe quoi.
La police de son côté patauge toujours, les pêcheurs remontent des morceaux de corps de la tamise (enfin, de la petite rivière suisse), la propriétaire de la pension de famille tombe amoureuse d'Orloff... et les shadocks pompent et pompent encore...

Cependant, même le spectateur le plus réfractaire sera obligé d'admettre que le film de Franco est fortement prenant, jamais ennuyeux, toujours maîtrisé et étrangement bien filmé. Alternant coup d'éclat, trouvailles surprenantes (l'aveugle qui reconnait l'éventreur grace à l'odeur d'une plante médicinale) et passages à vide démontrant un désintérêt relatif pour le sujet (longues séquences de meurtres pas toujours utiles) Jess Franco's Jack The Ripper est un film totalement bis qui en étonnera plus d'un. Tout amateur d'étrangeté se doit de l'avoir vu, les férus de polars victoriens et de Jack l'éventreur passerons leur chemin.
Pour ma part je le reverrai encore avec plaisir, ne serai-ce que pour la scène finale, qui voit un Klause Kinski très digne se rendre à la police en disant cette énigmatique réplique: "Serai-je Jack l'éventreur ? Il faudra le prouver."
-Bouh Hououou !
-Oui, c'est ça Jess...et quand est-ce que tu nous r'fais un bon film ?











.jpg)